
Une partie de ces histoires ont été écrites par Mr A. Bergeon, habitant de Boutiers St Trojan malheureusement décédé depuis 1997. Son épouse m'a très aimablement prêté son cahier où il consignait ses courtes, mais ô combien captivantes chroniques. Elles nous confirment, s'il en était besoin, combien les temps ont changé...
Je vous les révèle donc dans leur intégralité...
De nombreux autres articles proviennent de notre historien bien connu : Patrick Huraux !
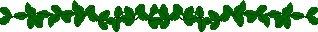




Haut de page
Haut de page
L'HIVER 1709 © Patrick Huraux
Les rigueurs de l’hiver de 1709 ne furent ni les premières calamités météorologiques ni les dernières.
Remontant dans le temps nous découvrons que :
- En 1172, en France, la douceur de l’hiver permit aux arbres de se couvrir de feuilles ; les oiseaux couvèrent et eurent des petits en février.
- L’année 1289 n’eut point d’hiver.
- En 1421, les arbres fleurirent au mois de mars et les vignes en avril ; les cerises mûrirent dans ce dernier mois et les raisons en mai.
- En 1528, les jardins furent émaillés de fleurs en janvier.
- L’année 1572 offrit les mêmes faits que celle de 1172.
- Il y eut des épis à Pâques en 1585.
- 1607, 1609, 1613 et 1617 furent remarquables par leur hiver très-doux.
- Il n’y eut ni gelée, ni neige en 1659.
- On n’alluma pas les poêles en Allemagne en 1692.
- En 1765, dans la nuit du 14 et 15 décembre, le passage de Saintonge à Bordeaux fut interrompu, les glaces durèrent jusqu’au 6 février 1766 environ 50 jours. Un vent du nord terrible souffla et tout fut glacé : pain, viande, vin et rivière. La Garonne fut totalement prise depuis Blaye jusqu’à Bordeaux. Les eaux du reflux se glaçaient au fur et à mesure.
- En 1778, il ne tomba une goutte d’eau du 7 mai au 1er octobre (Mortagne-sur-Gironde).
- Enfin, la douceur de la température de l’hiver de 1781, celle de l’hiver de 1807 et de 1822, sont citées comme exceptionnelles dans tous les traités de météorologie.
- Les deux hivers suivants furent aussi forts et vigoureux. Sans le blé d’Espagne c’était la famine.
Ces terribles évènements étaient donc loin d’être exceptionnels.
Les famines sont également relativement courantes, on en compte : 13 famines au XVIème siècle, 11 au XVIIème et 16 au XVIIIème.
L’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, mentionne que la famine qui sévit en 1693-1694, fit quelque 1.3 millions morts sur une population estimée à 20 millions.
A cela, il faut nécessairement rajouter les famines locales très fréquentes.
« On relevait en moyenne, une bonne année et deux mauvaises. Principales causes : des hivers terribles, des excès d’humidité ou des périodes de grande sécheresse. Ces années- la sont des cicatrices qui restent dans les mémoires pendant plusieurs générations. Ces épisodes contribuent à réduire les récoltes à une époque où les rendements sont très faibles.
Il y a ainsi des famines très importantes ... ». (Jean-Marc Moriceau, spécialiste de l’histoire rurale).
L’hiver de 1709 qualifié de « Grand Hiver » et qui reste ancré dans les mémoires comme l’un des plus calamiteux.
On estime qu’environ 1 million de français ont péri du froid et de ses conséquences.
La mort rodait partout.
« L’hiver de 1709, appelé Grand Hiver a marqué les esprits car une famine s’est développée à la suite de cet épisode météorologique.
Le jour de l’Epiphanie 1709, une brutale vague de froid frappa l’Europe entière.
De plus les vagues de froid étaient entrecoupées de redoux significatifs. Ainsi en février, il y eut un redoux de deux semaines suivi d’un froid assez vif qui tua les blés et provoqua une crise de subsistance»
« En l’année 1709, il fit un froid extrême, une disette qui survint fit périr un grand nombre d’habitants des classes pauvres et laborieuses. Les denrées de première nécessité se vendirent un prix excessif....les noyers, les figuiers gelèrent et les deux tiers des vignes durent être replantées ».
(P. Lacroix – Chroniques, faits historiques et traditions de l’Angoumois occidental – 1876).
Nos braves curés de campagne, sensibilisés aux malheurs de leurs paroissiens décrivent avec précisions les évènements dans les registres paroissiaux.
En voici quelques extraits :
François Delisle, curé de Réparsac :
« Son commencement fut terrible et tel qu’il ne sest jamais veu une année pareille depuis la création du monde ...
Le 6° janvier jour des Rois environ Les neuf heures du matin, il séleva un vent nord-ouest qui en un instant obscurcit l’air ... Le soleil qui s’étoit levé très beau le matin et prometoit un temps très tempéré may étoit froid extraordinairement et dura deux jours, ne finit que par une grande abondance de neige qui fit tomber sur la terre, et qui sy
conserva plus de trois semaines.
Le froid fut très excessif et tel quon en a jamais vu de semblable (et Dieu nous en préserve a lavenir).
Le grand fleuve de Charante gela a travers presque tout le long de son cours et fournit des ponts pour passer des châretes chargées ; l’eau que l’on versoit d’un peu de haut tomboit englace.
Les etangs et toutes les petites rivières furent entièrement glacées.
La véhémence de ce froid fit mourir tous les blés et presque tous les arbres, et surtout les noyers, figuiers, oliviers, pruniers, cerisiers etc…
Les arbres même les moins sujets au froid ne furent point a couvert de cette maligne influence, comme les lauriers, les palmiers, les cèdres, les buis etc…
Les couvrailles qui setoient portés belles ne servaient de rien, si cette année- la on amassa très peu de bons grains, et la baillarge qui jadis etoit la nourriture des pourceaux fut celle des hommes, même des riches et des nobles.
Elle valut le boiseau mesure de Jarnac 5 et 6 livres ; le froment monta jusqua 9 et 10 livres le boisseau même mesure ; les vignes gelèrent entièrement et moururent presque toutes, surtout les vieilles, le vin fut très cher et peu bon, sen etant vendu jusqua 300 livres le tonneau de vin rosé.
Les eaux de vie montèrent jusqua un prix excessif de 150 livres la barique, mais elles ne soient point a si haut prix que le vin, parce que le vin rendoit très peu cette année- la.
Les oyseaux moururent par le froid et par la faim, et le pays se trouva dégarni de perdrix et de lièvres et en un mot de tout gibier.
Les petits oyseaux venoient mourir aux pieds des homes et sembloient leur dire que Dieu qui étoit irité contre eux les faisoit servir de victimes en leurs places.
Les oyseaux ne furent pas les seuls qui moururent par la rigueur du froid, les homes nen furent pas exemps et plusieurs en moururent et surtout le voyageurs tant a pieds qua cheval.
Pour revenir donc a notre année ; le milieu, la fin de lyver, le commencement et presque tout le milieu du printemps furent très pluvieux, et causèrent dans plusieurs endroits des innondations qui firent périr plusieurs personnes et entrainèrent plusieurs maisons et même des villages entiers.
Le commencement de l’été fut assez agréable vers le milieu brulant qui décheycha les feuilles des arbres et de faire mourir les arbres que lyver avait commencé.
La fin de l’été fut très seiche et accompagnée de brouillards qui gâter les restes des grain et que la gelée avoit laissé sous l’eau.
Les grossailles et même les bons grains ne vinrent pas dans leur maturité Comme les autres années précédentes.
L’automne fut assez agréable. Les maladies provenant de tant d’intempéries des airs régnèrent sur les animaux et même sur les homes dont plusieurs moururent et les enfants languirent très longtemps.
La lune d’aoust qui couvroit septembre se leva après son plein trois jours de suite et presque tous les gens des champs s’en aperçurent.
Les corps ne sentirent pas seulement les révolutions et impressions des astres et des éléments, mais aussy les esprits et les humeurs qui changèrent et souffrir ... les tempéraments se changèrent la plupart.
Les mélancolies devinrent sanguins, les sanguins phlecmatiques et bilieux et atrabilaires.
Cette année la aporta de la révolution a toute la nature ».
François Delisle, âgé de 25 ans en 1709, fut curé de Réparsac de1707 à 1755.
« A Mortagne sur Gironde (Cozes) :
L’an 1709 le 6 janvier, il commença à faire un vent si violent et si rude et il tomba une grosse abondance de neige qui dura de 15 à 18 jours environ, qu’un grand nombre de gens perdait toutes les provisions à cause du froid.
La navigation fut interrompue de Blaye à Bordeaux à cause des glaces. Plusieurs bâtiments périrent et quantités d’arbres furent gelés ... ».
(Propos relevé et transmis par Désiré Callarec).
Touzac (Segonzac) :
« Rôle établi en mai 1709 pour fournir 698 livres de pain par semaine à 86 indigents répartis en 66 familles victimes de la gelée et de la disette. 47 sont taxés de 3 à 40 livres d’argent recouvrable sur les tailles.
Paroisse de 7 à 800 habitants.
De semblables réquisitions motivées par la nécessité eurent lieu sans doute dans d’autres paroisses ».
Curé de Bouex (Dignac) :
« L’année 1709, l’hiver a esté rude particulièrement vers la fin. Le six janvier il commenca un froid qui continua dix- sept jours avec de la neige épaisse de deux pieds qui dura autant que le froid, c’est-à-dire qui ne fut fondue entièrement que le 25 dudit mois. Le froid fut si rude que toutes les rivières furent glacées, à la réserve de la Toulvre, qui fut la seule sur laquelle on pouvoit faire moudre du bled. Il y eut plusieurs personnes qui moururent de froid. Les vieillars et les jeunes enfans furent plus exposés.
Un nommé Jean Mignot, dit Banlin, du village de La Forest, paroisse de Bouex, se trouvant tout glacé se mit dans un four, duquel on ne faisoit que sortir le pain, et lorsqu’il en sorti il se trouva tout bruslé sans avoir senti la chaleur.
Le curé de Marthon, nommé M. du Chauffât, fut trouvé tout glacé et mort.
Les oiseaux périrent et on fut longtemps sans en voir aucuns. On prenait les perdrix qui restaient dans les champs avec la main, comme aussi les lièvres, dont on en trouva quantité de morts. Les corbeaux et les pies, comme estant les plus endurcis au froid, ne trouvant rien de quoi manger, se dévoroient entre eux mesmes.
Outre le pain qui estoit gelé et duquel on ne pouvoit manger, le vin se glaca dans les barriques et on fut un temps sans en pouvoir tirer.
On ne pouvoit dire la messe, les espèces se glaceoient mesme contre un bon feu qu’on mettoit sur l’autel dans un réchot.
En un mot le froid et la neige furent si violentes que les vieillars de quatre- vingt dix ans n’avoient mémoire de rien de semblable. De plus, les arbres, noyers, chatagners sont entièrement morts. On en a vus qui avoient trois cens ans, par des titres qu’on trouve, qui sont pourtant morts.
Enfin on croit plus voir d’huyle de noix, à moin qu’on ne fasse venir de nouveaux noyers par le moyen des petits rejets qui poussent au pied des gros. Une grande partie des vignes sont aussi mortes, surtout celles qui estoient élevées et qui estoient vieilles. En un mot touttes les plantes ont esté cruellement attaquées, et on a vu des forêts entières de gros chesnes où à peine s’en trouvoit il qui eussent poussés. Il n’est pour ainsi dire resté point de bled sur la terre, ce qui causa une très grande famine. Le boisseau de froment, mesure d’Angoulesme, qui ne valoit l’année dernière que trente- cinq sols, en vaut neuf livres.
Des officiers qui sont en Flandre et qui adrivent en le pays raportent encore une plus grande famine.
On dit qu’à Bergue la mesure de froment qui est environ semblable à celle d’Angoulesme, c’est tant soit peu plus grande, vaut jusques à cinquante livres, et à deux lieux de Bergue elle vaut soixante- dix- huit livres. Toutes les troupes souffrent extrêmement, selon le rapport de ces officiers, et qui assurent que la guerre ne peut plus se faire et que tout est dans la dernière désolation cette année ».
Curé de la Rochette ( La Rochefoucauld) :
« En l’an 1709, l’hiver fut si cruel qu’il tua tous les noyers et châtaigniers et plusieurs arbres fruitiers, un très grand nombre de personnes de l’un et l’autre sexe moururent de froid, un nombre considérable d’oiseaux de toutes espèces périrent, le vin valait 400 livres le tonneau, heureusement on put semer du blé d’Espagne au printemps et une grande famine fut évitée ».
Les conséquences immédiates furent une flambée des prix des céréales (10 à 13 fois le prix), de la contrebande, parfois des émeutes et des maladies.
Les populations de nos petits villages de Boutiers, Saint-Trojan, Saint-Brice et autres ne furent pas épargnés par ces fléaux.
Haut de page
LES SCIEURS DE LONG DE BST © Patrick Huraux
François Suze (1812-1897), natif du Puy-de-Dôme, arrive vers 1837 à Saint-Trojan :
« 1838 - depuis 7 mois chez Louis Artaud fils, maître scieur de long, auparavant pendant 5 ans à Réparsac ».
Garçon scieur de long, il fait ses classes auprès de la famille Artaud.
Le 19 juin 1838, il épouse la fille de son maître, Madeleine Artaud, dont il aura 4 enfants :
1) Marie (1839-1930)
2) Henry (1840)
3) Isabelle (1846-1913)
4) Justine (1848).
Il entreprend quelques achats de bâtiments en janvier 1842 :
« Jacques Roy, propriétaire, époux de Jeanne Robinaud et René Jacques Roy, leur fils, propriétaire, époux de Marguerite Moreau, vendent à François Suze, scieur de long à Saint-Trojan, époux de Madeleine Artaud, une écurie avec grenier au-dessus à plancher, du levant à la rue du bourg conduisant à la Fontaine, du midi au bâtiment de Jean Lalande et du nord à la cour de Louis Roy, moyennant la somme de 300 francs ».
Après une vie bien chargée, il cesse son activité vers 1891.
Parmi sa main-d’oeuvre nous trouvons en 1832 Pierre Chaigne dont le fils Augustin tiendra une épicerie à Saint-Trojan .
Et une nouvelle fois, c’est le gendre de François Suze, qui va prendre le relai.Antoine Viossanges (1848-1931), né en Corrèze au village de Murat, arrive vers 1871 à Saint-Trojan et exerce le métier de scieur de long.
L’année suivante, le 6 février 1872, il épouse, la fille de son « patron » Isabelle ou Elisabeth Suze.
Ils seront les parents de :
- Antoine (1873-1873).
- Marie Antoinette Henriette (1875-1880).
- Maurice (1880-1952) qui sera propriétaire.
- Marie Antoinette (1884-1889).
Il est à la fois qualifié de scieur de long et marchand de planches.
Lui aussi, Antoine Viossanges n’est pas venu seul à Saint-Trojan, il est accompagné par son frère Léonard (1852-1922) scieur de long qui épousera une fille de Saint-Brice. Leur fils Adolphe Viossanges (1877-1934) exercera avec son père et son oncle la profession.
L’activité cesse vraisemblablement en 1934.
Les Viossanges emploient eux aussi un certain nombre d’ouvriers, dont Pierre Bessette (1886) – Probable parent d’Anne Bessette belle-mère de Maurice Viossanges.
D’autres scieurs de long se sont implantés sur notre commune. André Robert (1892-1971).
Mentionné comme scieur de long de 1928 à 1936, il possède une scierie (bâtiment en tôles) route de Boutiers (au-dessus de chez Francis Pelletier).
Les suivants exercent leur métier chez un patron : Suze ? Viossanges ?
François Lizajon : Garçon scieur de long, cité en 1848.
Claude Ferry, natif lui aussi du Puy-de-Dôme est cité scieur de long en 1859 et 1860.
Il demeure aux Tuileries de Boutiers, chez Poux.
Jean Mazeau, scieur de long cité en 1873.
Pierre Louis Ducros (1851-1915)
Demeurant le bourg de la commune. Scieur de long cité de 1878 à 1915.
Il est fils de Louis Ducros, affûteur.
Emile Gauthier (1896-1986).
Mentionné scieur de long en 1919.
L’atelier à Saint-Trojan.
Le bâtiment qui surplombe la Soloire et les anciens moulins, est le dernier atelier connu des scieurs de long.
Il s’agissait à l’origine d’une dépendance appartenant aux meuniers.
Auguste Larue, propriétaire cède par adjudication des 31 mai 1904 et 28 janvier 1905 cette petite construction élevée, sur un terre-plein dépendant à l’origine du communal, et comprenant deux pièces au rez-de-chaussée et de deux pièces au premier étage, un chai, une cour et dépendances, à Adolphe Viossanges, scieur de long et Noémie Faugeras, son épouse.
Ce bâtiment deviendra par la suite une maison d’habitation occupée par leur fille Marcelle et son mari René Bodin.
C’est encore aujourd’hui un habitat.
UNE BOUCHERIE A BOUTIERS © Patrick Huraux
L’implantation d’une boucherie à Boutiers remonte à l’année 1836 ….. il y a donc 185 ans.
Le premier boucher qui s’installe dans notre petite cité se nomme Léonard Roussit (voir aussi Roussy).
Ce personnage natif de Lusignac en Dordogne, né le 27 juin 1775 est le fils d’un Jean Roussit, également boucher.
S’il fait ses classes dans l’établissement de son géniteur, il est vite rattrapé par les évènements politiques et militaires de son époque. En 1799, il est chasseur à la 13ème demie brigade d’infanterie légère.
A son retour d’armée, il est jardinier à Tréguier en 1800.
Ensuite nous le trouvons exerçant le métier de boucher à Paimpol en 1806 puis à l’île de Bréhat en 1809. Il est également signalé à Lamballe en 1814.
Véritable itinérant, il débarque à Rouillac en 1816 et devient cultivateur et boucher. Il n’y reste pas.
On le retrouve de 1828 à 1830 à Saint-Martin de Cognac « aux Chassiers ». Il est alors qualifié de garçon boucher au Champ de Foire de Cognac.
Dès 1831, il devient boucher à Saint-Brice en compagnie de son fils Pierre.
Homme entreprenant, il jette désormais son dévolu sur Boutiers.
Pour cela, il fait l’acquisition d’un bâtiment et de quelques terrains : « Pierre Petit, charpentier et Magdeleine Sauvaget, de Boutiers, vendent à Léonard dit Bernard Roussi, boucher et Marie Chassat, demeurant Boutiers, plusieurs pièces de terre » (29 décembre 1836 – notaire Rambaud – 2E 20601). Il exerce peu de temps de 1836 à 1838, car en septembre 1839 il est dit « autrefois boucher ».
Léonard Roussit est donc à partir de 1836 à la tête de deux boucheries, Saint-Brice et Boutiers, qu’il léguera à deux de ses enfants.
Il décède à Saint-Brice le 22 février 1840.
Léonard Roussit avait épousé en premières noces à Tréguier le 2 octobre 1799, Marguerite Ropert (1779 – 1828) qui sera bouchère à ses côtés à Paimpol, puis en secondes à Saint-Martin le 29 juin 1830, Marie Chaussat, de Javrezac.
Ils seront les parents de : Charles Léonard Marie (1800) ; Charles (1801) qui deviendra boucher à Rouillac ; Louis Joseph (1806) ; Jean-Pierre (1807 – 1883) boucher à l’Echassier puis à Saint-Brice ; Nicolas César (1809 – 1809) ; Marie Caroline (1811) ; Marie (1814 – 1814) ; Jean (1816 – 1848) qui suit.
Jean Roussit, né à Rouillac le 2 août 1816, exerce d’abord à Boutiers avec son père de 1836 à 1840, puis parfois à Saint-Brice de 1839 à 1840 et enfin seul à Boutiers de 1840 à 1848.
Il s’unit à Saint-Brice le 9 septembre 1839 avec Jeanne Imbert.
En janvier 1838, Jean fait l’acquisition d’une moitié de maison et d’un jardin au bourg de la commune.
Malade, il teste le 28 mars 1848 et décède à Boutiers deux jours plus tard. Il avait 32 ans.
Il faudra attendre le 20ème siècle pour retrouver une boucherie sur notre territoire.
D’abord avec :
Henri Thomas, né à Cognac le 22 mai 1881, fils de Jean Jules Thomas (1842-1903) boucher à Cognac et de Marie Anne Gatineau.
Après avoir travaillé avec son père, il s’installe à Boutiers de 1904 à 1906.
« A Henri Thomas, boucher à Boutiers, 31 francs pour la viande fournie pendant les maladies qui se sont passées chez nous » (Extrait d’un livre de compte).
Il prend pour épouse à la Rochelle le 19 février 1914, Marie Louise Auguste.
Puis, nous trouvons installé « quartier du Petit Logis » de 1906 à 1907, Maurice Delage (né à Châteauneuf le 16 août 1860).
Enfin, en août 1979, Francis Pelletier ouvre sa boucherie rue des Platanes (lire ICI). Il cesse son activité après 30 années de loyaux services. Christophe Malevaut a pris la suite le 3 janvier 2009.
Haut de page

GRAND FROID EN DECEMBRE 1938 © Patrick Huraux
En raison des fortes gelées du mois de décembre 1938, la viticulture a été durement éprouvée.
« Les gelées exceptionnelles de décembre dernier ont causé au vignoble charentais un dommage considérable. Qu’on peut évaluer à un assez grand nombre d’hectares. La superficie des vignes complètement détruites dans la commune, ainsi que dans les communes voisines. Il en résulte pour les propriétaires, non seulement la perte totale de la récolte de cette année, mais la nécessité de remplacer le vignoble en s’imposant des frais énormes et en restant privés de toute récolte pendant au moins 4 ans. Que c’est dans ces conditions, la ruine totale de la plupart des sinistrés ».
On réclame donc auprès des pouvoirs publics, des indemnités...Haut de page

LE PHYLLOXERA A BOUTIERS © Patrick Huraux
Dans son ouvrage de 1876 consacré au phylloxéra, Maurice Girard (1822-1886), entomologiste mentionne son apparition dans notre commune : État progression phylloxéra du vignoble charentais de 1872 à 1874 - « J’ai pu observer l’insecte en juin, dès mon arrivée à Cognac, dans la commune de Boutiers, cru des Bois (190 hectares), à l’ouest du canton de Cognac, chez M. Daniaud, adjoint du maire, où le mal existait depuis environ deux ans, et l’on peut dire que depuis il a augmenté à chaque quinzaine. A cette époque, les vignobles du maire de la même commune, M. Raimbaud (*), étaient encore indemnes, ce qui tenait surtout à ce que ces vignobles, situés dans le bas et près de la Charente, étaient régulièrement inondés chaque hiver, ce qui explique la préservation ; ils furent envahis à l’automne de 1874, et l’on put constater l’insecte sur de belles vignes vertes, intactes en apparence, et centres de taches pour 1875, si l’inondation de l’hiver n’y porte remède ».
(*) Il s’agit de Jules Ollivier Rambaud (1822-1887) maire de Boutiers Saint-Trojan de 1865 à 1878.
© Philippe Dumas - Juillet 1999 - Tous droits réservés
(Dernière mise à jour : mai 2022)